Dans les rues faiblement éclairées de l'Angleterre victorienne, où la fumée de charbon peignait le ciel et où la crasse industrielle recouvrait chaque surface, la propreté personnelle devenait à la fois un défi pratique et un champ de bataille moral. La relation de cette époque avec l'hygiène reflétait ses divisions de classe marquées et ses attitudes sociales en constante évolution, créant une tapisserie fascinante de pratiques allant du primitif au surprenamment sophistiqué. Comme Charles Dickens l'a vivement illustré dans "Oliver Twist", les conditions sordides de l'East End de Londres contrastaient fortement avec les apparences impeccables maintenues dans le chic West End, où même l'air semblait plus pur.
Pour la classe ouvrière, le simple acte de se baigner était un luxe rarement accessible. Dans les immeubles surpeuplés de Londres, des familles entières partageaient un seul robinet d'eau froide, si tant est qu'elles aient eu la chance d'avoir de l'eau courante. Le bain du samedi soir devint un rituel hebdomadaire pour ceux qui pouvaient se le permettre, les membres de la famille se relayant dans la même eau, en commençant par le père, suivi de la mère, puis des enfants par ordre décroissant d'âge. Cette pratique a donné naissance à l'expression populaire "Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain", car au moment où venait le tour du plus jeune enfant, l'eau était si trouble qu'on pouvait littéralement ne pas voir le bébé dedans. Les bains publics, apparus dans les années 1840, offraient un répit à certains citadins, facturant un penny pour un bain froid ou deux pence pour de l'eau chaude. Les Bains Victoria de Manchester, ouverts en 1906 et surnommés "Le Palais de l'Eau de Manchester", illustraient la grandeur que ces établissements pouvaient atteindre. Ces lieux servaient à bien plus qu'à la simple hygiène ; ils devenaient des centres sociaux où les communautés se rassemblaient et où l'information circulait aussi librement que l'eau.
Les riches, quant à eux, bénéficiaient du privilège d'avoir des baignoires en cuivre ou en étain dans des salles de bains dédiées, assistés par des domestiques qui peinaient à transporter des dizaines de seaux d'eau chaude à l'étage. Les lettres de Lady Montagu de 1869 décrivent son rituel matinal, notant comment sa femme de chambre préparait de l'eau parfumée à la rose et disposait de fines serviettes turques – un contraste frappant avec la dure réalité de l'hygiène de la classe ouvrière. La reine Victoria elle-même donna l'exemple royal avec sa somptueuse salle de bain en marbre au château de Windsor, installée en 1850, qui comportait l'un des premiers mécanismes de douche en Grande-Bretagne – une cascade d'eau libérée en tirant sur une chaîne.
L'industrie du savon a connu une transformation remarquable au cours de cette période. Le savon victorien des débuts était un produit rudimentaire, fabriqué à partir de graisse animale et de lessive, suffisamment agressif pour enlever plusieurs couches de peau en plus de la saleté. Des fabricants innovants comme Andrew Pears ont révolutionné le marché dans les années 1860 avec son savon transparent, spécialement formulé pour être plus doux pour les peaux délicates. Les célèbres publicités de "Pears Soap", mettant en scène des enfants angéliques et des femmes glamour, sont devenues des représentations emblématiques du marketing victorien. En 1789, Pears engagea l'actrice Lillie Langtry comme première célébrité à endosser un produit dans l'histoire de la publicité, lui versant £100 pour affirmer qu'elle devait son teint au savon Pears. Les classes moyennes et supérieures adoptèrent avec enthousiasme ces nouveaux luxes, tandis que les familles ouvrières comptaient souvent sur des alternatives maison, telles que les rinçages au vinaigre et les gommages à l'avoine transmis de génération en génération.
0:00 Société victorienne et hygiène
10:25 La Grande Puanteur de Londres et l'assainissement
22:40 La bataille qui a changé la médecine
34:21 Comment les Victoriens ont révolutionné l'hygiène
Pour la classe ouvrière, le simple acte de se baigner était un luxe rarement accessible. Dans les immeubles surpeuplés de Londres, des familles entières partageaient un seul robinet d'eau froide, si tant est qu'elles aient eu la chance d'avoir de l'eau courante. Le bain du samedi soir devint un rituel hebdomadaire pour ceux qui pouvaient se le permettre, les membres de la famille se relayant dans la même eau, en commençant par le père, suivi de la mère, puis des enfants par ordre décroissant d'âge. Cette pratique a donné naissance à l'expression populaire "Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain", car au moment où venait le tour du plus jeune enfant, l'eau était si trouble qu'on pouvait littéralement ne pas voir le bébé dedans. Les bains publics, apparus dans les années 1840, offraient un répit à certains citadins, facturant un penny pour un bain froid ou deux pence pour de l'eau chaude. Les Bains Victoria de Manchester, ouverts en 1906 et surnommés "Le Palais de l'Eau de Manchester", illustraient la grandeur que ces établissements pouvaient atteindre. Ces lieux servaient à bien plus qu'à la simple hygiène ; ils devenaient des centres sociaux où les communautés se rassemblaient et où l'information circulait aussi librement que l'eau.
Les riches, quant à eux, bénéficiaient du privilège d'avoir des baignoires en cuivre ou en étain dans des salles de bains dédiées, assistés par des domestiques qui peinaient à transporter des dizaines de seaux d'eau chaude à l'étage. Les lettres de Lady Montagu de 1869 décrivent son rituel matinal, notant comment sa femme de chambre préparait de l'eau parfumée à la rose et disposait de fines serviettes turques – un contraste frappant avec la dure réalité de l'hygiène de la classe ouvrière. La reine Victoria elle-même donna l'exemple royal avec sa somptueuse salle de bain en marbre au château de Windsor, installée en 1850, qui comportait l'un des premiers mécanismes de douche en Grande-Bretagne – une cascade d'eau libérée en tirant sur une chaîne.
L'industrie du savon a connu une transformation remarquable au cours de cette période. Le savon victorien des débuts était un produit rudimentaire, fabriqué à partir de graisse animale et de lessive, suffisamment agressif pour enlever plusieurs couches de peau en plus de la saleté. Des fabricants innovants comme Andrew Pears ont révolutionné le marché dans les années 1860 avec son savon transparent, spécialement formulé pour être plus doux pour les peaux délicates. Les célèbres publicités de "Pears Soap", mettant en scène des enfants angéliques et des femmes glamour, sont devenues des représentations emblématiques du marketing victorien. En 1789, Pears engagea l'actrice Lillie Langtry comme première célébrité à endosser un produit dans l'histoire de la publicité, lui versant £100 pour affirmer qu'elle devait son teint au savon Pears. Les classes moyennes et supérieures adoptèrent avec enthousiasme ces nouveaux luxes, tandis que les familles ouvrières comptaient souvent sur des alternatives maison, telles que les rinçages au vinaigre et les gommages à l'avoine transmis de génération en génération.
0:00 Société victorienne et hygiène
10:25 La Grande Puanteur de Londres et l'assainissement
22:40 La bataille qui a changé la médecine
34:21 Comment les Victoriens ont révolutionné l'hygiène
- Catégories
- Architecte Architecte Intérieur - Décorateur
- Mots-clés
- documentaire, histoire, Époque victorienne

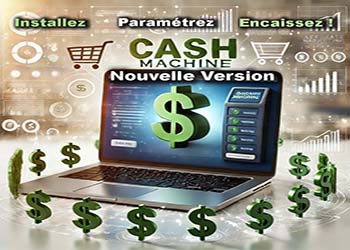
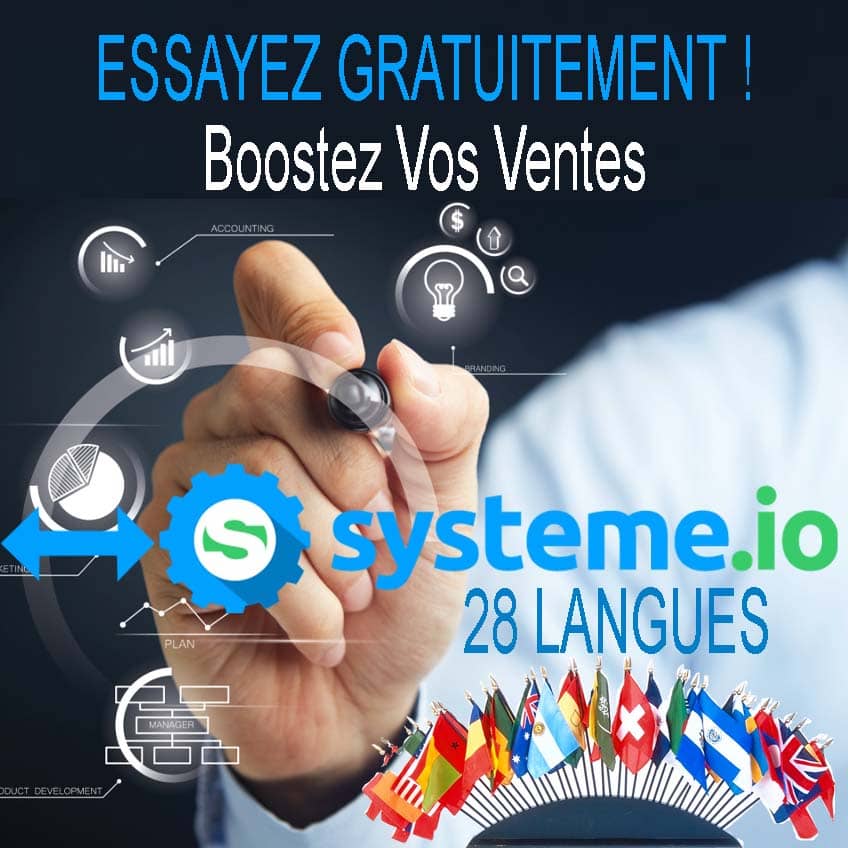


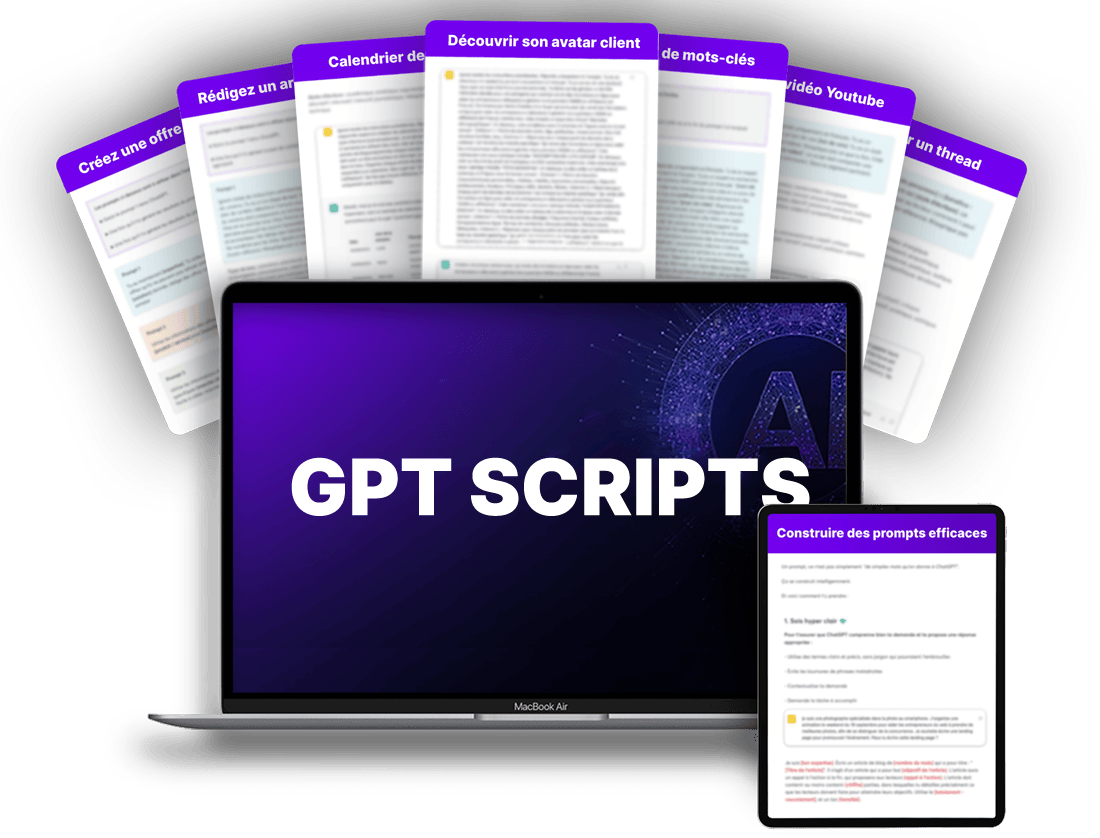












Commentaires